Officiellement, au Maroc, il n’y a actuellement aucun prisonnier politique ou d’opinion. C’est, en tout cas, ce que n’ont cessé de répéter l’ancien ministre de la Justice et des Libertés, Mustapha Ramid, et le Chef du gouvernement marocain lui-même, Abdelilah Benkirane, dans des interviews données à des chaînes de télévision étrangères. Et Mohamed Sebbar, secrétaire général du Conseil National des Droits de l’Homme au Maroc, d’abonder dans le même sens lors d’une conférence, tenue à Tanger le 30 novembre dernier, lorsqu’il a mis au défi aussi bien les ONG nationales qu’internationales de prouver l’existence d’un seul détenu politique au Maroc.
Pour les autorités marocaines, c’est d’une logique implacable. Ceci participe de la stratégie poursuivie par l’Etat marocain dès la fin de l’ère Hassan II pour répondre, d’une part à la pression des revendications du mouvement marocain des droits de l’Homme et, d’autre part, à celle venue de l’extérieur et surtout de ces alliés les plus proches, après la publication d’ouvrages tels que « Notre ami le roi » de l’écrivain Gilles Perrault, relatant les exactions, les atteintes graves aux droits de l’Homme au Maroc et l’existence de lieux de détention secrets comme celui de Tazmamart.
Pour lâcher du lest, le pouvoir marocain a commencé par amnistier les prisonniers politiques, autoriser le retour des exilés politiques et libérer les rescapés du bagne de Tazmamart, alors que, rappelons-nous, Hassan II n’avait jamais reconnu l’existence de prisonniers politiques et encore moins de disparus forcés. Quand Anne Saint-Claire, qui le recevait dans sa célèbre émission 7 jours/7, lui avait posé la question sur le centre secret de détention de Kalaât Mgouna, Hassan II avait répondu que Kalaât Mgouna était la capitale des roses au Maroc. Traduisez, circuler il n’y a rien à voir.
Et pourtant ! Quelques années plus tard, et toujours sous la pression des luttes démocratiques, l’Etat marocain va être obligé de céder un peu sur les violations graves des droits de l’Homme et de mettre en place des initiatives politiques comme l’adoption des principes universels des droits de l’Homme dans le préambule de la Constitution de 1996, l’appel à la primature de l’ancien opposant, le socialiste Abderrahmane Youssoufi, etc. Le plan de communication qu’il a mis en place, accompagné de ratification de quelques conventions internationales, lui a été très bénéfique sur le plan international.
Profitant de cet élan, Mohamed VI a tout de suite compris l’intérêt de le poursuivre. Il reforme la Moudawana (code du statut personnel marocain).Il met en place l’Instance Equité et Réconciliation (IER), censée tourner définitivement la page des années de plomb, et lui fait jouer carrément le rôle d’une instance assurant « la transition démocratique » sans le moindre coup politique. L’Etat marocain reconnait de fait la responsabilité de ses services de sécurité dans les exactions et les violations graves, et donc l’existence de prisonniers politiques, sur une période allant de 1956 à 1999 sans pourtant l’assumer, car, même s’il a accepté d’indemniser matériellement les victimes ou leurs ayant-droits à travers l’IER, il n’a jamais accepté que justice leur soit rendue. L’IER a interdit aux victimes auditionnées de prononcer ne serait-ce que le nom d’un tortionnaire ou d’un responsable de crime ou d’exaction.
La méthode s’étant avérée payante, le pouvoir marocain poursuit cette stratégie. Il multiplie les initiatives qu’il affiche à la face du monde pour en tirer bénéfice. C’est ainsi qu’aux revendications du mouvement 20-Février, né dans le sillage des révolutions qui ont secoué la région, il répond par la création du CNDH sur les cendres de l’ancien CCDH, tout en mettant à sa tête deux personnes connues par leur passé militant dans le domaine des droits de l’Homme (Driss El-Yazami et Mohamed Sebbar), ainsi que par le toilettage de la Constitution qu’il a soumise au référendum le 1er juillet 2011. Il n’oublie pas au passage de présenter sa candidature au Conseil onusien des droits de l’Homme et de mener une campagne médiatique à la hauteur de l’événement quand il en devient membre en novembre 2013. Il va même pousser un peu plus loin en annonçant tambours battants qu’après le Brésil, le Maroc recevra en 2014 la Forum mondial des droits de l’Homme !
On comprend dès lors le message que les responsables marocains veulent passer à la communauté internationale : Notre pays est respectueux des droits de l’Homme et il ne saurait donc y avoir de prisonniers politiques et d’opinion
Qu’en est-il dans la réalité ?
– Le dernier rapport de Juan Mendez, le rapporteur spécial de l’ONU sur la torture qui s’est rendu au Maroc en 2012, pointe les sévices et les contraintes physiques et psychologiques qui continuent à accompagner les interrogatoires de prévenus afin de leur extorquer des aveux qui sont utilisés comme seules preuves dans les procès.
– Le communiqué de presse, publié le 18 décembre dernier par le groupe de travail de l’ONU sur la détention arbitraire après sa visite au Maroc, fait état d’un rapport inquiétant quant à la persistance de la détention arbitraire dans ce pays.
– Khadija Ryadi, l’ex-présidente de l’AMDH, a reçu le prix 2013 de la cause des droits de l’Homme. Ce prix, qu’elle a aussitôt dédié aux prisonniers politiques au Maroc, est attribué tous les cinq ans par l’ONU aux défenseurs des droits de l’Homme à travers le monde.
Ces trois événements montrent à eux seuls que, contrairement à ce que prétendent les autorités marocaines, il y a bel et bien des prisonniers politiques et d’opinion, mais que l’Etat marocain ne leur reconnait pas ce statut, et pour cause :
– Les militants et les défenseurs des droits de l’Homme sahraouis sont jugés avec des chefs d’accusation de droit commun. Ils sont considérés comme des criminels et les tribunaux évitent de les juger pour leur opinion par rapport au conflit du Sahara Occidental (groupe de Gdeim Izik par exemple).
– Les syndicalistes et les ouvriers sont jugés sur la base de l’article 288 du code pénal qui fait d’eux des gens violents et qui empêchent les usines de fonctionner et les autres de travailler (groupe Mineurs d’Imider par exemple).
– Les étudiants, membres de l’UNEM, sont souvent accusés de violences et de rassemblements non autorisés (groupe UNEM-Fès-Meknès-Marrakech par exemple).
– Les diplômés chômeurs, dont l’association ANDCM n’a toujours pas de récépissé légal, sont généralement arrêtés après une dispersion violente de leurs rassemblements et condamnés pour rassemblement armé non autorisé, destruction de biens publics, violences à l’égard de fonctionnaires de l’Etat dans l’exercice de leurs fonctions (groupe ANCDM-Béni Bouayach par exemple).
– Les jeunes militants du mouvement 20-Février sont souvent violentés avant d’être arrêtés et condamnés pour violence contre les agents de la police, destruction de biens publics ou, des fois, pour détention ou trafic de drogue (groupe 20-Février-Rabat-El-Hoceima-Casablanca par exemple).
– Les journalistes qui ne courbent pas l’échine sont, soit condamnés à s’exiler et arrêter leur publication, soit accusés ou condamnés pour fait de terrorisme sur la base de la loi antiterroriste de 2003 (Ali Anouzla, Mustapha El-Hasnaoui, Aboubakr Jamai, etc. par exemple)
On peut continuer longtemps à lister toutes les victimes des procès politiques et d’opinion qui ne disent pas leur nom. Une chose est sûre. Ces victimes ont toutes un dénominateur commun : Elles sont toutes victimes de procès inéquitables, parfois montés de toutes pièces, et leurs chefs d’accusation ne correspondent aucunement à la réalité de leurs activités militantes ou à leurs opinions. Les autorités marocaines évitent soigneusement les accusations qui donneraient à ces procès la qualité de procès politique ou d’opinion.
Heureusement que, face à elles, il y a les organisations de défense des droits de l’Homme qui viellent et surveillent les atteintes aux libertés. Celles-ci dénoncent ces procès maquillés en procès de droit commun et n’hésitent pas à interpeller les autorités marocaines sur leurs engagements internationaux en matière de respect des droits de l’Homme. Elles apportent leur soutien sous différentes formes à ces victimes qu’elles considèrent des prisonniers politiques ou d’opinion. C’est le cas par exemple de l’observation des procès et la désignation d’avocats que fait l’AMDH au Maroc.
Et c’est aussi le cas de la campagne internationale de parrainage qu’a lancée l’ASDHOM en novembre 2012 et placée sous le patronage de l’écrivain Gilles Perrault. Cette campagne de parrainage qui fait l’objet d’un suivi hebdomadaire régulier a permis d’établir la liste des prisonniers politiques et d’opinion. Selon son dernier bilan, ce sont 261 au total dont 183 purgent une peine d’emprisonnement et 78 attendent d’être jugés.

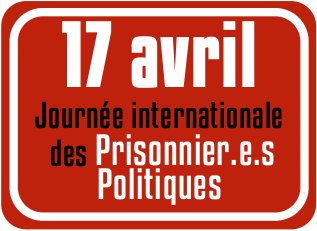
Comments are closed.